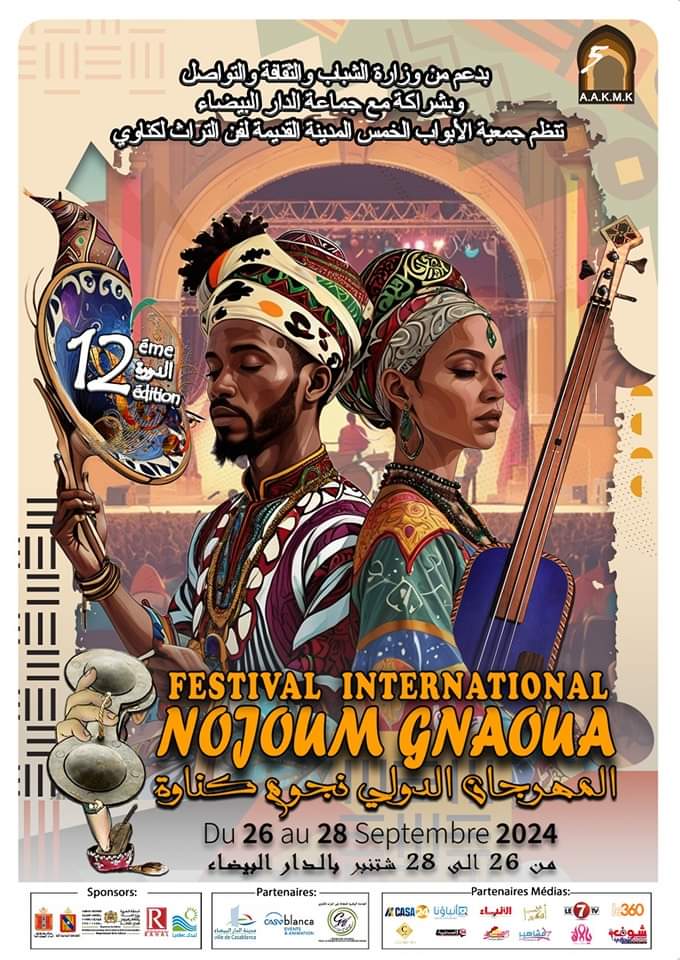Vêtement emblématique du Maroc, la djellaba incarne l'alliance parfaite entre élégance, praticité et tradition. Cette longue tunique à manches longues, surmontée d'une capuche pointue appelée "koub", est bien plus qu'un simple habit; elle représente un patrimoine vestimentaire séculaire qui s'adapte avec grâce aux évolutions de la société marocaine contemporaine.
Une histoire tissée à travers les siècles
Les origines de la djellaba remontent à plusieurs siècles, puisant ses racines dans l'habillement berbère et arabo-andalou. Initialement portée comme vêtement de protection contre les rigueurs climatiques - chaleur intense du jour et fraîcheur des nuits désertiques - elle a évolué pour devenir un marqueur culturel et social. Traditionnellement confectionnée en laine pour l'hiver et en coton léger ou lin pour l'été, sa conception reflète une adaptation parfaite à l'environnement marocain.
"La djellaba est un vêtement qui raconte notre histoire. Chaque région, chaque tribu a développé ses propres codes et motifs, transformant ce vêtement utilitaire en une expression artistique de l'identité marocaine." - Leila Boutaleb, ethnologue spécialiste du costume traditionnel
Diversité régionale et symbolique
Le Maroc offre une remarquable diversité de djellabas, variant selon les régions et les communautés. Dans le Rif, elles arborent souvent des rayures colorées; à Fès, elles se distinguent par leur raffinement et leurs broderies subtiles; dans l'Atlas, elles sont plus épaisses et ornées de motifs berbères géométriques. La couleur joue également un rôle symbolique: le blanc, traditionnellement réservé aux hommes de religion et aux occasions solennelles, symbolise la pureté; le brun ou le beige était porté par les paysans; tandis que les couleurs vives ornent les djellabas féminines de cérémonie.
L'art de la confection
La fabrication d'une djellaba traditionnelle relève d'un véritable artisanat d'art. Entièrement cousue à la main, elle nécessite l'intervention de plusieurs artisans spécialisés: le tisserand qui prépare l'étoffe, le tailleur qui découpe les pièces selon des patrons ancestraux, et enfin les brodeuses qui ornent le vêtement de motifs décoratifs. Les techniques de passementerie, notamment pour les finitions du col, des poignets et des boutonnières (appelées "âkad"), requièrent une dextérité exceptionnelle transmise de génération en génération.
Évolution contemporaine
Si la djellaba demeure un incontournable du vestiaire traditionnel, elle a su se réinventer pour séduire les jeunes générations. Des créateurs marocains comme Zineb Joundy ou Noureddine Amir proposent des réinterprétations modernes, jouant avec les coupes, les matières et les ornements. La "djellaba fashion" conquiert désormais les défilés internationaux, tandis que les modèles plus classiques continuent d'être portés au quotidien ou lors des fêtes religieuses comme l'Aïd el-Fitr ou les mariages.
Un patrimoine vivant
Face à la mondialisation vestimentaire, plusieurs initiatives visent à préserver ce patrimoine. L'Institut Royal de la Culture Amazighe documente les styles traditionnels, tandis que des coopératives artisanales, souvent gérées par des femmes, perpétuent les savoir-faire ancestraux. Simultanément, l'engouement touristique pour les produits authentiques contribue à la revalorisation de ce vêtement identitaire, désormais ambassadeur du "made in Morocco" à l'international.