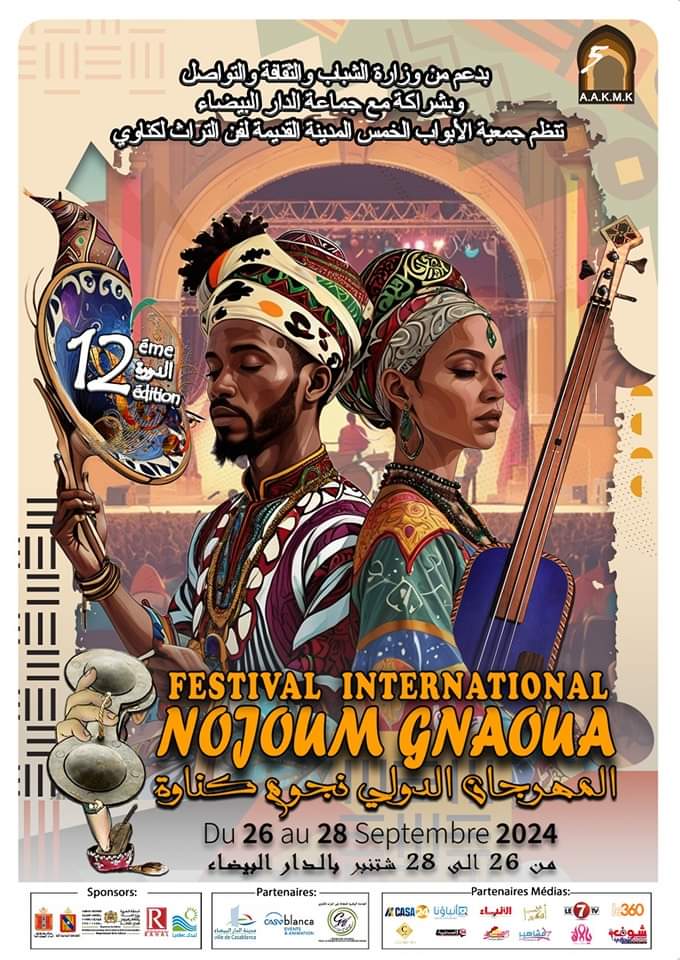Fondée au IXe siècle et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, la médina de Fès (Fès el-Bali) constitue l'une des plus vastes zones urbaines médiévales préservées au monde. Véritable musée à ciel ouvert, cet enchevêtrement de 9.400 ruelles étroites abrite un patrimoine architectural exceptionnel et perpétue des traditions artisanales millénaires, faisant de cette cité impériale le cœur battant de l'identité marocaine et l'incarnation vivante de son âge d'or culturel et intellectuel.
Une fondation impériale
L'histoire de Fès débute en 789 lorsque Moulay Idriss Ier établit la première ville sur la rive droite de l'oued Fès. Son fils, Idriss II, fonde en 809 une seconde cité sur la rive opposée. Ces deux noyaux urbains, auxquels s'ajoutent les quartiers créés par les vagues successives de réfugiés andalous et kairouanais, fusionnent progressivement pour former Fès el-Bali (la vieille ville). Durant la dynastie des Mérinides (XIIIe-XVe siècles), Fès connaît son apogée et devient un centre intellectuel et spirituel majeur du monde islamique, rivalisant avec Cordoue, Bagdad et Le Caire.
"Quiconque n'a pas marché dans les ruelles de Fès, entendu l'appel du muezzin résonner entre ses murs centenaires et senti les parfums de ses épices et de son cuir tanné, ne peut prétendre connaître l'âme véritable du Maroc." - Hassan Tazi, historien et conservateur du patrimoine fassi
Un urbanisme médiéval préservé
La médina de Fès se caractérise par son architecture vernaculaire exceptionnellement bien conservée. Ses hautes murailles almohades, percées de majestueuses portes monumentales comme Bab Boujloud ou Bab Ftuh, protègent un trésor urbanistique organisé selon les principes de la ville islamique traditionnelle. Les quartiers d'habitation (houma), composés de demeures introvertives aux façades austères cachant des riads luxuriants, s'articulent autour de mosquées de quartier, de hammams, de fours communautaires et de fontaines publiques. Au cœur de ce dédale s'élèvent les édifices qui témoignent de la grandeur passée: l'université Al Quaraouiyine (fondée en 859, la plus ancienne au monde encore en activité), la medersa Bou Inania avec son horloge hydraulique unique, le sanctuaire de Moulay Idriss II et d'innombrables palais aux cours ornées de zellige et aux plafonds de bois sculpté.
Les souks: conservation d'un artisanat ancestral
La médina abrite un réseau complexe de souks organisés par corps de métiers, perpétuant une tradition économique séculaire. Chaque quartier artisanal a sa spécialité: le souk des dinandiers où résonne le martèlement du cuivre, le souk des teinturiers avec ses cuves colorées, le souk des menuisiers embaumé par l'odeur du bois de cèdre, et les célèbres tanneries Chouara où le cuir est travaillé selon des méthodes inchangées depuis le Moyen Âge. Ces espaces ne sont pas de simples lieux commerciaux, mais de véritables conservatoires vivants où les maîtres artisans transmettent leurs savoirs ancestraux aux apprentis selon le système traditionnel des corporations (hanta).
Un mode de vie unique
Au-delà de son patrimoine architectural, la médina de Fès est caractérisée par un mode de vie particulier qui résiste à la modernisation. Les familles fassies perpétuent des traditions culinaires spécifiques comme la pastilla aux pigeons, les tanjias ou les pâtisseries au miel et aux amandes. Les cérémonies du thé, les hammams hebdomadaires et les célébrations des fêtes religieuses suivent des rituels ancestraux. Cette dimension immatérielle, faite de savoir-vivre, d'hospitalité et de raffinement, constitue l'essence même de "l'esprit fassi", reconnu dans tout le royaume pour son élégance et son érudition.
Défis de conservation et renaissance contemporaine
Malgré sa valeur inestimable, la médina a traversé une période difficile au XXe siècle avec l'exode des familles aisées vers la ville nouvelle et la dégradation progressive de son bâti historique. Depuis les années 2000, un ambitieux programme de réhabilitation, porté par l'Agence pour la Dédensification et la Réhabilitation de la médina de Fès et soutenu par la Banque mondiale, a permis de restaurer des centaines d'édifices menacés. Parallèlement, un phénomène de gentrification se développe avec la transformation de riads en maisons d'hôtes de luxe, attirant une clientèle internationale en quête d'authenticité. Ce renouveau touristique, s'il apporte des ressources nécessaires à la préservation du patrimoine, pose également la question délicate de l'équilibre entre conservation culturelle et développement économique durable pour les 150.000 habitants qui font de cette médina non pas un simple vestige du passé, mais un organisme urbain vivant et en constante évolution.