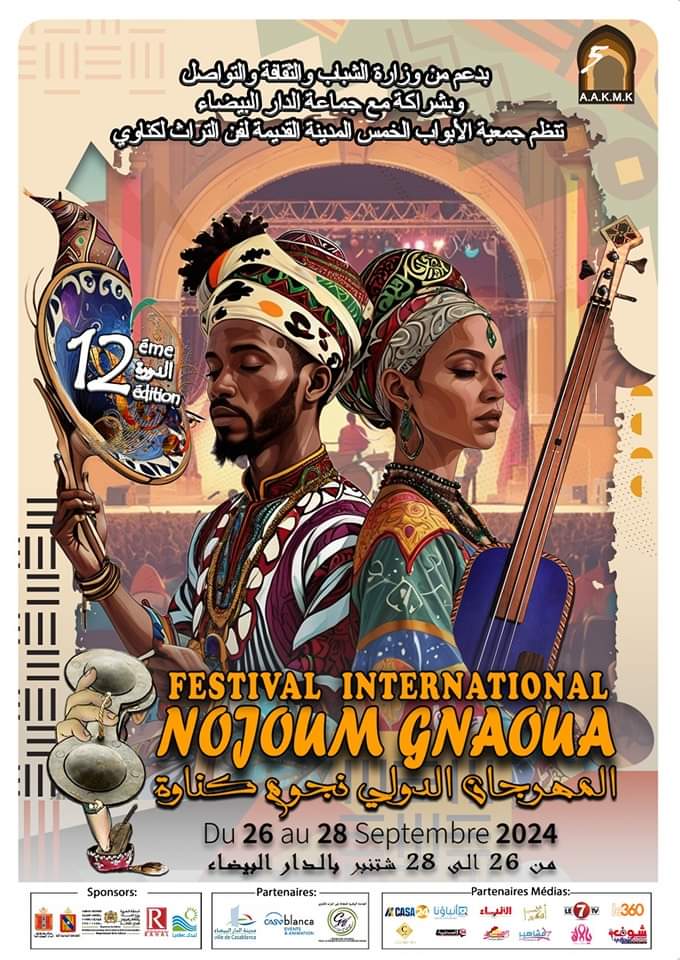Née dans l’Atlas marocain au début du XIIe siècle, la dynastie almohade fut à l’origine d’un empire colossal s’étendant du Sahara au centre de l’Espagne. Plus qu’un pouvoir politique, elle porta un projet religieux réformateur basé sur l’unicité divine. Entre grandes batailles, innovations architecturales et centralisation rigoureuse, les Almohades ont marqué profondément l’histoire islamique du Maghreb et d’Al-Andalus.
Une révolution religieuse dans l’Atlas
Le mouvement almohade émerge vers 1120 sous l’impulsion d’Ibn Tumart, un prédicateur amazigh originaire du Souss. Formé entre Fès, Cordoue et Bagdad, il prône un retour rigoureux au monothéisme pur (tawhid) et condamne la décadence des Almoravides. Il se proclame Mahdi et rassemble autour de lui des tribus berbères dans le Haut Atlas, créant un État théocratique embryonnaire.
Après sa mort, son disciple Abd al-Mu’min prend le relais et transforme le mouvement en une véritable armée conquérante. En 1147, il prend Marrakech, capitale des Almoravides, et fonde officiellement la dynastie almohade.
Un empire à son apogée
Sous Abd al-Mu’min puis ses successeurs, les Almohades bâtissent un empire immense allant du sud marocain jusqu’à Tunis, et de l’Atlantique jusqu’à l’Èbre en Espagne. Ils transfèrent la capitale de Marrakech à Rabat, qu’ils fondent comme ville fortifiée et centre politique — la Tour Hassan devait en être le minaret d’une immense mosquée jamais achevée.
Le règne d’Abu Yaqub Yusuf (1163–1184) et de son fils Yaqub al-Mansur (1184–1199) marque l’apogée de l’empire. Ce dernier défait les armées chrétiennes à la célèbre bataille d’Alarcos (1195) et renforce la domination musulmane en Espagne. Il fait construire la Kasbah des Oudayas à Rabat et la Giralda à Séville.
Un modèle de gouvernance centralisé
Contrairement à leurs prédécesseurs Almoravides, les Almohades imposent une administration rigide et centralisée. Les oulémas, choisis pour leur fidélité au dogme almohade, encadrent la société religieusement et socialement. Les pouvoirs tribaux sont affaiblis, remplacés par des gouverneurs nommés directement par le calife.
Leur réforme religieuse met l’accent sur la rationalité et l’unicité divine absolue. Ils rejettent les écoles juridiques traditionnelles et favorisent une lecture littérale du Coran, tout en soutenant la philosophie et la logique, notamment sous Averroès (Ibn Rushd), qui bénéficie du patronage almohade à Cordoue.
Un rayonnement artistique et scientifique
L’architecture almohade, sobre mais monumentale, est reconnaissable par ses arcs en fer à cheval brisés, ses minarets carrés, et ses décors géométriques épurés. La Koutoubia de Marrakech, la Tour Hassan de Rabat, et la Giralda de Séville en sont les plus éclatants exemples.
Les Almohades protègent les savants, philosophes, médecins et mathématiciens, faisant rayonner leur empire comme un centre de connaissance. Des manuscrits précieux circulent entre Fès, Marrakech, Cordoue et Tunis.
Déclin et perte de l’Andalousie
La grande défaite de Las Navas de Tolosa en 1212 face aux royaumes chrétiens marque le début du déclin almohade. Leurs pertes militaires successives en Espagne accélèrent la chute. L’unité interne se fissure, des révoltes éclatent, et les Hafsides, Zianides et Mérinides émergent progressivement dans différentes régions de l’ancien empire.
Marrakech tombe aux mains des Mérinides en 1269, mettant fin à la dynastie. Les Almohades disparaissent, mais leur influence architecturale, religieuse et politique se prolonge bien au-delà de leur chute.
Un héritage durable
De Rabat à Séville, les monuments almohades continuent d’émerveiller les visiteurs. Leur rêve d’unification du monde musulman occidental a laissé une empreinte structurante sur les dynasties suivantes, notamment les Mérinides et les Hafsides.
L’influence intellectuelle des penseurs soutenus par les Almohades — comme Averroès — a dépassé les frontières du monde musulman et marqué l’Europe médiévale à travers la redécouverte aristotélicienne.
Informations complémentaires
Les sites majeurs de l’héritage almohade sont accessibles au Maroc et en Espagne : la Koutoubia, la Tour Hassan, la Giralda, ainsi que les murailles de Rabat et les fondations de la ville de Tinmel, berceau du mouvement. Des expositions permanentes au Musée Mohammed VI de Rabat et au Musée Archéologique de Séville leur sont également consacrées.